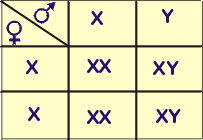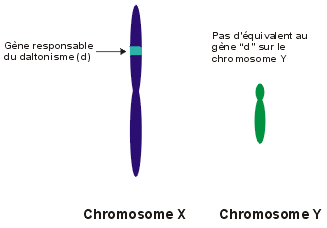|
|
 |
| Chapitre 1 | Chapitre 2 | Chapitre 3 | Chapitre 4 | Chapitre 5 |
|
Détermination du sexe Ci-dessous, vous pouvez observer deux caryotypes, celui d'une femme et celui d'un homme. Voyez-vous une différence ?
En effet, il y a une différence au niveau de la 23e paire de chromosomes; c'est pourquoi on a placé ces chromosomes un peu en retrait des autres sur le caryotype. Chez la femme, les deux chromosomes numéro 23 sont, comme toutes les autres paires, à peu près identiques (on sait qu'il y a de petites différences au niveau des gènes, comme c'est le cas pour toutes les paires d'homologues). Cependant, chez l'homme, les deux homologues 23 sont différents. L'un des deux est à peu près identique aux chromosomes numéro 23 de la femme, même taille et même types de gènes. On a appelé " X " ce chromosome. L'autre numéro 23 est beaucoup plus court. On l'a appelé " Y ".
|
Un caryotype, c'est une photographie de tous les chromosomes du noyau prise au moment où ceux-ci sont visibles dans la cellule (pendant la mitose). La photographie, après avoir été agrandie, est découpée et les chromosomes sont dis-posés suivant certaines règles établies.
|
||||||||
| Puisqu'ils
peuvent différer l'un de l'autre, on a appelé hétérochromosomes
les deux chromosomes numéro 23. On appelle autosomes
les chromosomes formant les 22 autres paires.
La détermination du sexe dépend de cette 23e paire de chromosomes. Un individu XX est une femme alors qu'un individu XY est un homme.
Est-ce
un garçon ou une fille? Chez la femme, l'ovule contient un chromosome X (en plus des 22 autres évidemment) alors que chez l'homme, la moitié des spermatozoïdes contiennent un chromosome X et l'autre moitié, un chromosome Y. La détermination du sexe qu'aura l'enfant ne dépend donc que du spermatozoïde qui fécondera l'ovule. Si c'est un " X " on aura une fille, si c'est un " Y " ce sera un garçon. À la conception, il y a donc toujours une chance sur deux d'obtenir un garçon (XY) et une chance sur deux d'obtenir une fille (XX).
|
Une
femme est XX.
Un homme est XY.
Pourtant,
à la naissance, on obtient plus de garçons |
||||||||
|
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la plupart des gènes portés opar les hétérochromosomes, plus particulièrement par le chromosome X, ne sont pas impliqués dans la différenciation sexuelle. Ils codent pour une grande variété de protéines impliquées dans une non moins grande variété de fonctions métaboliques. Ce n'est que récemment qu'on a découvert pourquoi le chromosome Y induit le sexe masculin. Ce chromosome contient un gène (appelé sry) dont l'activité détermine la formation des organes génitaux masculins. Chez l'homme comme chez la femme, ce sont les mêmes structures embryonnaires qui forment les gonades, c'est-à-dire les testicules ou les ovaires. La protéine codée par le gène " masculinisant " découvert sur le Y se fixe sur les cellules des gonades embryonnaires et en induit la transformation en testicules. Sans cette protéine, il se formerait des ovaires. À peine formés, les testicules commencent à sécréter l'hormone mâle testostérone. La testostérone activera alors d'autres gènes situés sur d'autres chromosomes. Ce sont ces gènes qui seront responsables de la formation des organes reproducteurs masculins. S'ils demeurent inactifs, ce qui se produit s'il n'y a pas de testostérone sécrétée, il se formera des organes reproducteurs féminins. Que se produirait-il chez un enfant XY dont le gène masculinisant situé sur le Y demeurerait inactif ?
|
|
||||||||
|
Hérédité liée au sexe Chez la femme, les deux chromosomes X sont semblables, l'un à l'autre, comme sont semblables l'un à l'autre les chromosomes de chacune des 22 autres paires d'homologues. Cependant, chez l'homme, il n'en est pas de même. La plupart des gènes présents sur le X n'ont aucun équivalent sur le Y. Les hommes ne possèdent donc qu'un seul exemplaire de ces gènes, l'exemplaire légué par le chromosome X qu'ils ont hérité de leur mère. Génétiquement parlant, les hommes, il faut bien le dire, sont plus fragiles que les femmes. Il suffit, en effet, qu'un de ces gènes uniques soit anormal pour que l'homme présente l'anomalie. Il n'a pas comme la femme la " roue de secours " d'un autre exemplaire de ce gène. Comme les gènes anormaux sont en général récessifs, une femme dont un de ces gènes est anormal pourrait utiliser l'exemplaire normal situé sur l'autre chromosome X, ce que ne peut faire l'homme.
|
Pour ce qui est des gènes portés par le chromosome X, un homme ne peut pas être homozygote ou hétérozygote puisqu'il ne possède qu'un seul exemplaire de ces gènes. On le dit alors hémizygote pour ces gènes. |
||||||||
| On
appelle gènes liés au sexe
ces gènes qui, chez les hommes, n'ont pas d'allèles
sur le Y.
On connaît de nombreuses maladies génétiques causées par ces gènes liés au sexe. Ces maladies touchent en général les hommes puisque, pour être affectée, une femme devrait posséder deux fois (un sur chaque X) le gène responsable de l'anomalie. Voir : Chromosome X C'est le cas, par exemple, du daltonisme, anomalie (il serait exagéré, ici, de parler de maladie) caractérisée par la difficulté ou même l'impossibilité de distinguer les couleurs. Cette anomalie est due à un gène récessif anormal lié au chromosome X (c'est-à-dire un gène situé sur le chromosome X, mais sans équivalent sur le Y). Un homme daltonien présente le génotype X d Y alors que le génotype normal est X D Y.
Remarquez la notation X d ; elle signifie que le gène d fait partie du chromosome X. Jusqu'à maintenant, il n'avait jamais été nécessaire d'indiquer le chromosome qui portait le gène étudié. Dans les cas d'hérédité liée au sexe, il est important de bien le préciser.
|
Gène
lié au sexe
Gène présent sur le X, mais qui n'a pas d'allèle sur le Y.
|
||||||||
|
En fait, deux gènes différents, situés à deux endroits différents sur le X peuvent, s'ils sont anormaux, causer le daltonisme. Le premier gène est essentiel à la perception du vert alors que le second est essentiel à la perception du rouge. On connaît deux formes anormales du gène permettant de percevoir le vert. La première forme atténue la perception de cette couleur alors que la seconde cause la cécité complète à cette couleur. De même, on connaît deux formes anormales du gène permettant de percevoir le rouge. La première forme ne fait qu'atténuer la perception de cette couleur alors que la seconde l'empêche totalement. Enfin, on connaît un type de daltonisme, très rare, caractérisé par une absence totale de toute perception des couleurs (ces personnes voient donc en " noir et blanc "). Le gène anormal responsable de ce type de daltonisme n'est pas lié au sexe (il n'est pas porté par le chromosome X mais par une des 22 autres paires de chromosomes). |
|||||||||
|
Parmi d'autres anomalies dues à un gène anormal porté par le X (et non le Y), on retrouve:
|
|||||||||
| Le
corpuscule de Barr
Chez la femme, un seul des deux chromosomes X est réellement actif dans les cellules somatiques. L'autre X, très peu actif, est isolé des autres chromosomes et forme une petite masse compacte, appelée corpuscule de Barr. Une coloration appropriée permet d'observer au microscope, dans le noyau des cellules somatiques, ce corpuscule qui apparaît comme un point foncé. Le test de féminité que doivent passer toutes les athlètes féminines participant aux jeux olympiques (afin de prouver qu'elles sont bien des femmes) consiste simplement à prélever dans la bouche quelques cellules de surface et à les observer au microscope afin de mettre en évidence le corpuscule de Barr. On a proposé
ces dernières années de remplacer ce test par un autre
consistant à mettre en évidence le gène masculinisant
porté par le chromosome Y. Cependant, cette dernière
méthode soulève certains problèmes éthiques. Par contre, les deux X sont actifs dans les cellules embryonnaires et dans les cellules germinales dont la reproduction par méiose produit les ovules. |

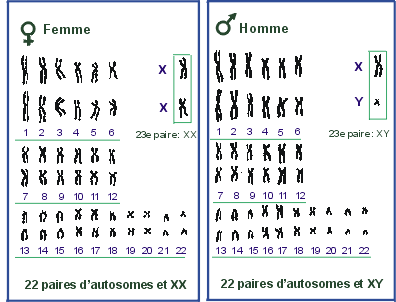
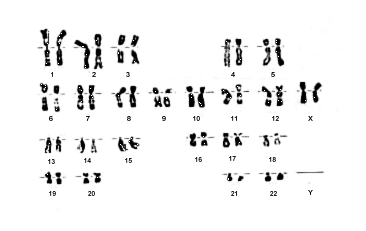
 C'est elle !
C'est elle !