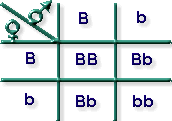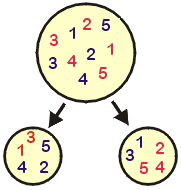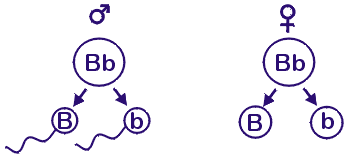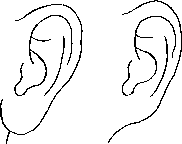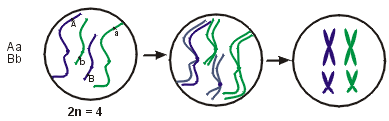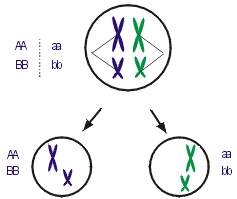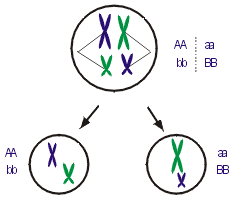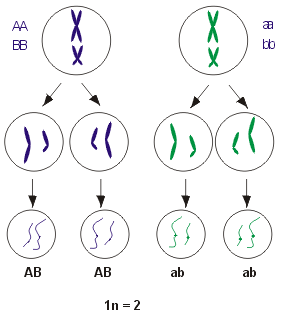|
GÉNÉTIQUE |
|
| Chapitre 1 | Chapitre 2 | Chapitre 3 | Chapitre 4 | Chapitre 5 |
|
La méiose On le sait maintenant, lors de la fécondation, il y a fusion entre le noyau du spermatozoïde et celui de l'ovule. Les chromosomes de l'un s'ajoutent aux chromosomes de l'autre.
|
|
||||||||
|
S'il en était ainsi, le nombre de chromosomes doublerait à chaque génération. Ce n'est pas le cas tout simplement parce que les gamètes, c'est-à-dire les cellules reproductives, spermatozoïdes et ovules, ne contiennent que 23 chromosomes. Ils ne possèdent qu'un seul exemplaire de chacun des chromosomes : un seul no 1, un seul no 2, un seul no 3 et ainsi de suite jusqu'au no 23.
|
|
||||||||
|
Méiose
d'une cellule à 10 chromosomes (cinq paires de chromosomes
homologues). Vous pouvez
constater qu'il n'y a qu'un seul exemplaire de chaque paire dans
chacune des deux cellules obtenues de cette division.
|
En fait, comme nous le verrons plus loin, la méiose est un processus un petit peu plus complexe que ce que vous voyez sur cette illustration
À la méiose, les chromosomes homologues se séparent |
||||||||
|
On obtiendra donc de la méiose d'une cellule à 46 chromosomes (23 paires d'homologues) des cellules à 23 chromosomes. Au cours de la méiose, chaque chromosome homologue se sépare de son autre homologue. Tous les gamètes, c'est-à-dire les spermatozoïdes et les ovules, sont produits par méiose. Il n'y a donc qu'un seul exemplaire de chaque chromosome dans ces cellules.
|
|||||||||
| Une
cellule possédant des paires de chromosomes homologues est
dite diploïde, alors qu'une
cellule ne possédant qu'un seul exemplaire de chaque chromosome
sera dite haploïde.
Les bactéries ne possèdent qu'un seul chromosome, elles sont donc haploïdes. Chez certains insectes, comme les abeilles ou les fourmis, la femelle est diploïde alors que le mâle est haploïde. |
|
||||||||
|
La transmission des caractères Comme les chromosomes homologues se séparent à la méiose, on peut donc s'attendre à ce qu'un homme de génotype Bb (donc hétérozygote aux yeux bruns) fabrique 50% de spermatozoïdes portant le chromosome dans lequel il y a l'allèle B et 50% de spermatozoïdes portant le chromosome de l'allèle b. De même, chez une femme au génotype Bb, 50 % des ovules portent le gène B et 50 % le gène b.
Que se produit-il alors lorsqu'un couple, lui Bb et elle aussi Bb, font un enfant ? Puisqu'on ne peut savoir à l'avance quel spermatozoïde fécondera quel ovule, il faut envisager toutes les possibilités :
|
|
||||||||
|
Il est plus simple d'illustrer toutes ces possibilités par un diagramme appelé échiquier de Punnett.
Sur la ligne du haut, on place les types de gamètes mâles produits et dans la première colonne, les types de gamètes femelles. À l'intersection de chaque ligne et de chaque colonne, on place le génotype produit de l'union du gamète mâle avec le gamète femelle. Comme on peut aisément le constater, il y a donc :
Ce couple a donc une chance sur quatre d'avoir un enfant aux yeux bleus. Peut-on alors conclure que s'ils ont quatre enfants, forcément l'un d'eux aura les yeux bleus ?
|
On pourrait aussi faire l'inverse, placer les gamètes femelles sur la ligne du haut et les gamètes mâles dans la colonne de gauche. Le résultat serait le même.
Quelle serait
la probabilité pour ce |
||||||||
|
Il y a relativement peu de caractères physiques apparents, tant chez les humains que chez les autres animaux, qui ne sont codés que par une seule paire d'allèles. La plupart du temps, il existe beaucoup plus que deux allèles ou, encore, le trait physique est codé par un grand nombre de gènes différents occupant des emplacements différents sur les chromosomes. C'est pourquoi, un couple formé d'un noir et d'une blanche n'aura pas des enfants ou blancs ou noirs dans une proportion de trois pour un. En fait, la couleur de la peau dépend de nombreuses paires d'allèles différentes. C'est la combinaison de ces allèles dont nous avons hérité de nos parents qui détermine notre couleur de peau. Comme il y a plusieurs paires d'allèles, le nombre de combinaisons possibles est très élevé. Chaque combinaison détermine une couleur de peau pouvant varier de blanc à noir en passant par toutes les nuances de brun. Exemples
de caractères physiques visibles chez l'humain déterminés
par une seule paire d'allèles :
Voir: Tongue-Rolling is NOT a Simple Inherited Trait |
|
||||||||
|
Les maladies héréditaires De nombreuses maladies, les maladies héréditaires, sont causées par la présence de gènes anormaux codant donc pour des protéines anormales qui ne remplissent pas adéquatement leur fonction. La surdité héréditaire Chez de nombreux mammifères, dont l'homme, la surdité peut être causée par un gène anormal empêchant le développement normal du système auditif. Le gène responsable de cette infirmité est récessif par rapport au gène normal. Si on indique par S le gène normal et s le gène anormal, un enfant sera sourd s'il est ss.
|
|||||||||
|
La fibrose kystique (ou mucoviscidose)
Il est difficile de déterminer si une personne est porteuse ou non d'une maladie génétique causée par un gène récessif. On peut repérer, dans l'ADN d'une cellule, la présence d'un gène anormal seulement si on connaît la séquence de ce gène (c'est-à-dire les nucléotides qui le forment et l'ordre dans lequel ils sont enchaînés). Il faut donc, afin de mettre au point un test de dépistage, localiser d'abord le gène, l'isoler du reste de l'ADN, puis le séquencer, c'est-à-dire l'analyser, nucléotide par nucléotide. On a ainsi localisé, il y a quelques années, sur le chromosome no 7, le gène responsable de la fibrose kystique, ce qui a permis de mettre au point un test de dépistage. Mais, il y a encore beaucoup de travail à faire. Même si on connaît près de 4000 maladies génétiques différentes, on n'a isolé et séquencé le gène fautif que dans quelques cas seulement. Chaque humain est porteur d'environ 200 à 300 gènes récessifs anormaux. Sachant cela, pouvez-vous expliquer pourquoi les risques d'engendrer des enfants anormaux sont augmentés lorsque l'union est consanguine ? Généralement, le gène anormal responsable d'une maladie génétique est récessif. On connaît cependant quelques exceptions. C'est le cas, par exemple, de la chorée de Huntington, maladie occasionnant de graves désordres neurologiques. Le gène anormal responsable de cette maladie est dominant par rapport au gène normal. Il suffit donc d'être porteur du gène anormal pour avoir la maladie. Généralement, les premiers symptômes ne se manifestent qu'entre 35 et 50 ans. La maladie se caractérise par des mouvements spasmodiques incontrôlables et par une détérioration irréversible des capacités intellectuelles. Il n'y a actuellement aucun traitement connu. L'évolution est inexorable et conduit à la perte complète du contrôle des mouvements et à la démence.
|
|
||||||||
|
Les étapes de la méiose La division méiotique est un petit peu plus complexe que ce qui a été décrit plus haut. La méiose se déroule en deux étapes. Comme dans la mitose, chacune des deux étapes se divise en prophase, métaphase, anaphase et télophase. Méiose I
Méiose II
Figure complète de la méiose de la cellule à 2n = 4 chromosomes Bilan de la méiose : À la fin de la méiose, on obtient quatre cellules à 1n chromosomes (23 chromosomes dans chaque cellule dans le cas d'une cellule humaine).
Le résultat de la méiose varie d'une division à l'autre selon la façon dont les homologues se séparent (pour chacune des 23 paires, on ne sait jamais lequel va dans une cellule et lequel dans l'autre). Ainsi, une cellule humaine (23 paires de chromosomes) peut se diviser de plus de 4 millions de façons différentes. On peut donc obtenir 2 23 gamètes différents. |
Il serait un peu compliqué de faire une figure avec une cellule humaine à 46 chromosomes. Sur la figure ci-contre, la cellule qui subit la méiose est une cellule diploïde à 2n = 4 chromosomes (deux paires de chromosomes homologues). La première paire porte les allèles A et a alors que la seconde porte les allèles B et b.
Première
division de la méiose:
Les homologues (dédoublés) se séparent. Deuxième
division de la méiose:
|
||||||||